
(Auguste Rodin, La porte de l'Enfer, Zurich)
J’habite ma propre demeure,
Jamais je n’ai imité personne,
Et je me moque de tous les maîtres
Qui ne se moquent pas d’eux-mêmes.
Ecrit au-dessus de ma porte. [1]
Frapper à la porte de la baraque à poison n’est pas sans dangers... Avant de tourner la page, attardons-nous quelque peu sur l’épigraphe qui figure en ouverture la Gaya Scienza. Quoi de plus propice, pour désigner la puissance illusionniste opérée par la métaphore, que cet épigraphe qui se présente au lecteur comme un épigramme inscrit au-dessus de la porte du philosophoir ? La porte instaure une séparation entre un dedans et un dehors, une limite entre une intériorité et une extériorité, un passage entre les deux rives du livre. Après tout, si tenté que la porte soit ouverte, faut-il encore consentir d’y entrer ? Comme disait Montaigne : « Celui qui entre me fera honneur, celui qui n’entre pas me fera plaisir »[2] A mesure que nous pénétrons au sein de cette extériorité qu’est le livre (hupomnèsis), nous cédons la place au sein de notre propre intériorité (mnémé). Est-ce Thésée qui pénètre à l’intérieur du labyrinthe[3], ou ce dernier qui laisse entrer le Minotaure dans sa caverne ? Ouvrir le livre reviendrait à prendre le risque d’abolir la séparation entre le lecteur et l’écrivain au sens de Barthes, à se retrouver « front contre front » pour reprendre la formule de Tourgueniev. A bien y réfléchir, la porte symbolique ne demande pas à être « ouverte » ou « refermée », mais consiste davantage à établir un certain rapport dialogique avec le lecteur : « la loi de la double relation »[4] A moins de la réduire à une simple figure de style, la métaphore poétique est un sortilège enchanteur qui permet de transformer les mots en images, la réactivation de la métaphore déploie - dans l’esprit du lecteur - une charge symbolique dont la force de suggestion produit une certaine conversion du regard [5]. La présence de la métaphore poétique au seuil du récit n’a pas échappée à la vigilance de Guillaume Métayer qui présente l’épigraphe de la façon suivante : « Ce poème qui occupe la page de garde du Gai Savoir est présenté comme « inscrit sur la porte d’entrée » du philosophe. Cette épitaphe se présente donc symboliquement comme une épigramme, et même une inscription réelle. Elle contient un avertissement au lecteur, au seuil du livre. L’ouvrage s’ouvre sur une première métaphore, celle de la maison, lieu de vie du philosophe, mais aussi espace premier d’intelligibilité du monde, symbole du « chez-soi » nécessaire à l’élaboration des valeurs et des idées »[6], nous passons à regret sur la finesse de sa présentation de(s) épigramme(s) comme « transcription des saillies de la folie dionysiaque ». Les plaisanteries, ruses et vengeances comportent une telle variétés de formes qu’il me semble difficile de les regrouper sous un même qualificatif, nous considérons que l’épigramme du Gai Savoir n’a pas d’autre équivalent au sein du récit, mise à part le fragment posthume dédié à Schopenhauer l’immortel :
« Entrée aux Enfers – Je t’ai sacrifié mainte brebis noires – à propos de quoi les autres brebis se plaignent »[7]
On peut suggérer que ce titre évocateur fait référence à l’Enéide de Virgile[8], ou que la forme épigrammatique nous conduit devant les portes de l’Enfer de Dante : « Par moi l’on va dans la cité des pleurs ; par moi l’on va dans l’éternelle douleur ; par moi l’on va chez la race perdue. La Justice mut mon souverain Auteur : la divine Puissance, la suprême Sagesse et le premier Amour me firent. Avant moi ne furent créées nulles choses, sauf les éternelles, et éternellement je dure : vous qui entrez, laissez toute espérance ! »[9]. Même constat concernant l’épigramme du Gai Savoir, puisqu’il fait implicitement allusion aux Nuées d’Aristophane : « Ouvre-moi, ouvre vite le philosophoir ; et fais-moi voir au plus tôt Socrate. J’ai hâte d’être son disciple »[10] ainsi qu’au portique de l’académie platonicienne « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre ». C’est précisément là que se dessine les deux sentiers que nous proposons d’arpenter : le platonisme inversé et le christianisme parodié. Les thématiques abordées sont prélevées au sein de l’épigramme : la métaphore de l’habitat (la baraque à poison), la tentation mimétique (le singe de Zarathoustra) et l’autodérision (le rire d’or de la joyeuse méchanceté).
Problématique : le philosophe fait-il preuve d’autodérision en disant qu’il n’a jamais imité personne ?
Les dialogues du contre-dialecticien. Avant de procéder à un quelconque regroupement entre les sources, commençons par examiner de plus près la fonte et la frappe des aphorismes [11]. Alors que le choix d’une thématique résulte le plus souvent d’une décision arbitraire, une approche structurelle du récit prend en compte la nature des sources, permet de les reclasser les aphorismes en fonction de leurs appartenances à un genre littéraire, de distinguer la multiplicité des régimes narratifs et la variété des styles d’écriture, etc. A commencé par ces formes empruntées à la littérature antique et médiévale que le philologue cherche à restaurer, comme les dithyrambes du rhapsode et les lieds du trouvère germanique. Ce qui revient à porter le monocle du philologue classique pour apprécier l’œuvre... d’un philologue classique, afin de goûter aux douceurs qui font le plaisir de l’esthète, débusquer les petites excentricités du graphomane, admirer les trouvailles du collectionneur, avec un degrés de proximité tel que nous portons un regard nostalgique sur ses propres sources d’inspiration. Cette classification ne laisse rien au hasard, dans la mesure où nos regroupements sont constitutifs de la matérialité même des sources, le lecteur n’a pas d’autre alternative que de les reconnaître et de les appréhender comme tels (diktat), nous les qualifions donc de groupement(s) objectif(s). On serait presque tenté de dire qu’il s’agit-ici d’un jeu d’enfant, car notre activité consiste à agencer les pièces du puzzle (rätzel), à rassembler les aphorismes qui possèdent la même forme, la même fonte et la même frappe, de reconstituer éclats après éclats le Miroir de Dionysos. Geste proprement inverse à celui de l’auteur, puisque de notre côté nous séparons les métaux de la mine [12], alors que du sien l’auteur les agences subtilement au sein de sa narration de manière séquencée. Le lecteur pantin regroupe ensuite les rétrospectives de nature autobiographiques contenues dans les préfaces (1884-1886) et le Ecce Homo (1888), afin de suivre minutieusement les indications prescrites par l’auteur (istos), avant de reproduire le geste en regroupant progressivement les thématiques apparentés (mascula) etc. Ces prolégomènes passés, le lecture peut alors commencer... Il suffit de regrouper les « dialogues » parsemés dans l’œuvre du contre dialecticien, pour s’apercevoir que le narrateur privilégie deux genres très spécifiques : le soliloque et la diatribe. C’est ainsi que le contre-dialecticien emploi l’instrument dialectique pour lutter contre la dialectique. Alors que le soliloque est un « dialogue » sans interlocuteur (ventriloquie), la diatribe est quant à elle un « dialogue » avec un interlocuteur fictif (marotte). Or, il est intéressant de remarquer qu’il s’agit à chaque fois de monologues déguisés qui donnent l’illusion du dialogue[13], autrement dit des faux semblants (eidolon). Pour l’heure, nous laissons les soliloques (II) et les exhortations poétiques (III) de côté, afin d’analyser les diatribes présentes dans Aurore, le Gai Savoir et le Ainsi parlait Zarathoustra. Ces entretiens entre le maître et son disciple coïncident étroitement avec les thématiques prélevées dans l’épigramme (mimétique et autodérision). Cependant, nous devons présenter les métaphores de l’habitat, afin de respecter l’ordre des thématiques présentes dans l’épigramme (diktat).
Cette festivité n’est donc pas dépourvue de certains grands dangers, si l’on considère que l’invité patiemment attendu n’est autre que le bouc émissaire de l’hécatombe, les vaches et les brebis noires sont très appréciées à l'heure du sacrifice. Point de rêverie pour le promeneur solitaire, car en ce lieu il est plus prudent de s’y inviter soi-même. De petits pas discrets pour de grands regards indiscrets, le lecteur doit pénétrer le livre avec le pas léger et vigilant du chasseur. Le lecteur qui tenté par la gourmandise s’inocule avec appétit les fruits de l’ivresse, entame alors une danse endiablée avec Dionysos sur son dos... Mais ne nous laissons pas tromper par l’image ni entraver par la toile du rêve, le banquet de Zarathoustra est un festin solitaire auquel l’hôte s’invite à présider et à manger à sa propre table. En définitive, nous somme résolument seul en face de ces livres tentateurs que la tentation nous amène ici à ouvrir.
« Il va en enfer, qui suit ton chemin ? Eh bien, je paverai de bonnes maximes le chemin de mon enfer » (Fragment posthume d'hiver 1888)
-----------------------------
[1]Gaya Scienza, épigramme d’ouverture.
[2]Formule citée par Nietzsche in Gai Savoir, « ordre du jour pour le roi » (ref. rêve selon Pascal), § 22.
[3]Aurore, § 60. L’auteur emploi la métaphore du labyrinthe pour décrire l’habitat de son âme.
[4]Second principe de l’école du style : in Lou Andréa Salomé, Nietzsche à travers ses œuvres, 1894. Un rapport dialogique au sens de Humboldt.
[5]Une définition liminaire, car nous reviendrons en détail sur la thèse de Jean Michel Rey intitulée L’enjeu des signes, nous reprenons ici la notion de « réactivation de la métaphore ».
[6]Guillaume Métayer, Friedrich Nietzsche : Epigrammes, « Commentaires autour du Gai Savoir », le fragment posthume indiqué étant mentionné à la suite du passage relevé.
[7] « Etudes théorétiques », fragments posthumes de 1873 découpés et regroupés sous le titre trompeur de Le livre du philosophe, aphorisme 157. Ce titre nous ramène également l’aphorisme « descente aux enfers » dans [8]Opinions et Sentences Mêlées, § 408
[9]Virgile, Enéide, livre V : « devant le vestibule, aux portes des enfers »
[10]Dante Alighieri, La Divine Comédie, livre I : Enfers, ouverture du chant III.
[11]Aristophane, Les Nuées, prologue, 180-181. (idem pour la préface d’Aurore)
[12]Rétrospective de 1887, ou avant propos de la Généalogie de la Morale, 8
[13]Giorgio Colli, Après Nietzsche, « citation interdite ».
[14]Nous empruntons le terme de « monologue déguisé » au commentateur Luca Lupo, in Nietzsche et la philosophie de l’esprit libre : « notes pour une lecture du voyageur et son ombre ».








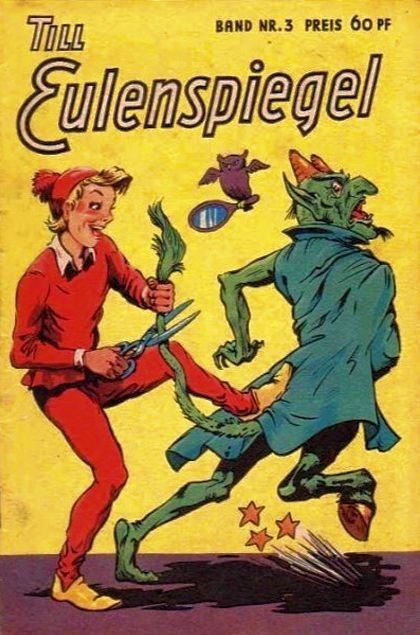


/image%2F1562993%2F20180523%2Fob_384e1a_sans-titre.png)
